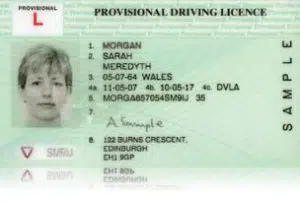En France, un agent public en arrêt maladie voit sa rémunération suspendue le premier jour de son congé, à l’inverse du salarié du secteur privé qui conserve une indemnisation dès le deuxième jour seulement. Cette règle, instaurée puis supprimée à plusieurs reprises, continue de susciter des débats sur sa légitimité et son efficacité.
Les organisations syndicales dénoncent une mesure inéquitable, tandis que certains responsables politiques mettent en avant un dispositif de responsabilisation et de maîtrise des dépenses publiques. Les conséquences sur l’absentéisme et la santé des agents restent discutées, au cœur de rapports officiels et d’études contradictoires.
Comprendre la journée de carence dans la fonction publique : définition et cadre légal
La journée de carence s’applique dès le premier arrêt maladie des agents publics. Concrètement, le premier jour du congé de maladie n’est pas rémunéré. Cette règle touche aussi bien les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public. Le jour non payé concerne l’ensemble du traitement indiciaire ainsi que les primes, indemnités, indemnité de résidence et nouvelle bonification indiciaire (NBI). Seul le supplément familial de traitement (SFT) reste versé pour les bénéficiaires.
La carence n’est pas systématique. Elle ne s’applique pas si l’arrêt est prolongé dans les 48 heures, ni en cas d’affection de longue durée (ALD), de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), de congé de longue maladie (CLM), de congé de longue durée (CLD) ou de congé de maternité. D’autres congés liés à la grossesse, à la perte d’un enfant ou à des blessures en service échappent également à cette règle.
Du côté des agents de droit privé, présents dans certains établissements publics, ce jour de carence ne s’applique pas, car ils relèvent d’un régime différent. Le droit public distingue donc nettement les statuts au sein même du secteur public.
Fixée par la loi, l’instauration du délai de carence vise à rapprocher la gestion de l’absentéisme des agents publics de celle en vigueur dans le secteur privé, tout en restant fidèle à une logique de protection sociale propre au service public.
Quels effets concrets pour les agents concernés ?
La journée de carence dans la fonction publique change la donne pour les agents publics dès le moindre arrêt maladie. Première conséquence : une perte de rémunération immédiate. Pour les agents aux revenus modestes, AESH, personnels techniques, contractuels précaires, ce manque à gagner, même temporaire, pèse lourd sur le budget. Les syndicats, à l’image de la FSU-SNUipp, dénoncent la pression subie par ces personnels, parfois forcés de choisir entre leur santé et leur équilibre financier.
Ce dispositif fait naître un phénomène bien connu des ressources humaines : le présentéisme. Par peur de perdre une journée de salaire, un agent malade préfère venir travailler, au risque d’aggraver sa situation ou de contaminer ses collègues. Sur le terrain, les effets se font sentir : la fréquence des arrêts courts diminue, mais la part des arrêts longs progresse. Le collectif s’en ressent : propagation des infections, efficacité en baisse, ambiance fragilisée.
Un sentiment d’injustice s’installe aussi. Appliquer la même règle à tous, sans tenir compte des différences de salaire ou de conditions de travail, alimente la frustration. La qualité de vie au travail se détériore, la confiance s’effrite, et le lien social s’affaiblit. Au final, la question de la carence dans la fonction publique ne se limite pas à l’absentéisme : elle touche au sens même du service public.
Fonction publique et secteur privé : une comparaison des dispositifs de carence
Comparer les régimes côté public et côté privé, c’est comprendre deux logiques distinctes. Depuis 2018, le secteur public applique un jour de carence : le premier jour d’arrêt maladie n’est pas payé pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public. Les agents de droit privé qui travaillent dans la fonction publique, quant à eux, ne sont pas concernés et relèvent du régime général.
Dans le secteur privé, la règle diffère : trois jours de carence avant que l’Assurance Maladie ne prenne le relais, avec indemnisation à partir du quatrième jour. Mais la plupart des salariés, près des deux tiers, bénéficient d’accords collectifs qui permettent à leur employeur de compenser tout ou partie de cette perte de revenu.
Voici un résumé pour saisir les différences entre les deux secteurs :
- Fonction publique : 1 jour de carence non payé, sauf exceptions (ALD, maternité, CITIS…)
- Secteur privé : 3 jours de carence, généralement pris en charge par l’employeur grâce à des accords collectifs
Le gouvernement défend l’idée d’un alignement du délai de carence entre public et privé, pour garantir l’équité. Pourtant, dans la pratique, la majorité des salariés du privé ne subit pas vraiment la carence grâce à la couverture de leur entreprise. À l’Assemblée nationale, cette volonté d’alignement alimente des échanges tendus : les syndicats estiment que la mesure risque de pénaliser davantage les agents publics, déjà confrontés au gel du point d’indice ou à la disparition de la GIPA.
Au fond, la question du délai de carence renvoie à la capacité de l’État employeur à assurer une vraie protection sociale et à traiter tous les personnels de façon équitable, au-delà d’un simple calcul comptable.
Enjeux d’équité, impacts économiques et questions de société autour de la journée de carence
L’application de la journée de carence nourrit un débat de fond sur la justice sociale et le traitement réservé aux agents publics face aux salariés du privé. Les syndicats y voient une mesure qui accentue les différences au lieu de les réduire. Sur le terrain, l’argument de l’équité se heurte rapidement à la réalité : la plupart des salariés du privé sont couverts par leur employeur pour la période de carence, ce dont les agents publics ne bénéficient pas.
Les conséquences économiques de la mesure font l’objet de toutes les attentions. L’IGAS et l’IGF estiment qu’un allongement du délai de carence à trois jours dans la fonction publique générerait environ 300 millions d’euros d’économies chaque année. Pour Bercy, la généralisation porterait la facture à 1,2 milliard d’euros. Mais ces chiffres ne disent pas tout : la Cour des comptes souligne que la suppression de la rémunération le premier jour d’arrêt maladie réduit certes les arrêts brefs, mais encourage le présentéisme, agents malades présents sur leur poste, propagation des virus, santé globale en berne.
La fonction publique souffre déjà d’un manque d’attractivité. Le gel du point d’indice, la disparition de la GIPA et le sentiment d’injustice ne font qu’aggraver ce malaise. Les catégories les plus exposées, souvent en situation précaire, ressentent d’autant plus les effets de la carence. Jean-François Amadieu (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) évoque une détérioration du climat social et une baisse de l’engagement des agents, tandis que la CPME alerte sur les risques de hausse des coûts de prévoyance si la logique de carence se généralise. Ici, la comptabilité n’explique pas tout : c’est l’équilibre même du service public, et la cohésion de ses équipes, qui se trouvent remis en question.
Face à ce dispositif, la fonction publique avance sur une ligne de crête, tiraillée entre impératifs financiers, promesse d’équité et exigences humaines. Reste à savoir quel choix la société fera demain pour celles et ceux qui la servent au quotidien.