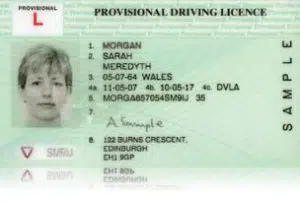En France, un enfant ne peut avoir plus de deux parents laussi reconnus. L’adoption par le conjoint du parent biologique ne se fait pas automatiquement en cas de remariage ou de recomposition familiale. La loi impose l’accord explicite de l’autre parent biologique, sauf en cas de retrait de l’autorité parentale ou de décès.
L’adoption simple, procédure la plus fréquente dans ces situations, maintient le lien de filiation d’origine tout en créant un lien juridique avec le nouveau parent. Certaines démarches administratives, souvent méconnues, conditionnent la recevabilité de la demande devant le tribunal judiciaire.
Pourquoi l’adoption de l’enfant de sa compagne séduit de plus en plus de familles
L’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin gagne du terrain en France, stimulée par les mutations sociales et les avancées législatives. La réforme de la loi du 21 février 2022 a facilité l’accès à la parentalité et allégé certains processus, en particulier pour les familles issues d’une PMA ou recomposées. La société française s’ouvre aux multiples réalités familiales : familles homoparentales, parents séparés ayant refait leur vie, partenaires de pacte civil de solidarité ou simples compagnons de route. Face à cette pluralité, les besoins de stabilité affective et juridique se font entendre.
En adoptant, on crée un lien de filiation authentique entre l’enfant et le parent social, celui qui, au quotidien, veille, accompagne et élève. L’enfant profite alors des mêmes droits que s’il était né du couple : héritage, exercice conjoint de l’autorité parentale, accès à la nationalité française. Derrière cette démarche, un objectif : offrir à l’enfant des repères clairs, le préserver des incertitudes que la vie peut réserver, qu’il s’agisse d’une séparation ou d’une disparition prématurée. L’adoption, qu’elle soit simple ou plénière, balaye les zones de flou et assure à chacun une place reconnue.
Toutes les familles peuvent s’engager dans cette démarche. Couples mariés, partenaires pacsés, concubins : la volonté de sceller un projet familial en tenant compte de la réalité de chacun transcende les statuts. On ne gomme pas le passé, on n’efface pas les origines ; on choisit de donner une cohérence nouvelle à la cellule familiale, en reconnaissant la diversité des adultes investis auprès de l’enfant. À l’heure où la famille se réinvente, adopter l’enfant de sa compagne, c’est acter l’engagement de tous.
Quelles conditions faut-il remplir pour adopter l’enfant de son ou sa partenaire ?
Adopter l’enfant du conjoint ou du partenaire exige de concilier l’envie de bâtir une filiation solide et le respect des droits de l’enfant comme de ses parents biologiques. Le Code civil pose des règles précises. Le candidat à l’adoption doit être marié, pacsé ou en concubinage avec le parent de l’enfant. Aucune durée minimale de vie commune n’est imposée, mais la stabilité du foyer reste scrutée par le tribunal.
Que l’enfant soit mineur ou majeur, la procédure s’adapte. Pour les mineurs de plus de treize ans, leur consentement personnel est requis, sauf impossibilité manifeste ou intérêt supérieur de l’enfant. Si l’autre parent biologique exerce encore tout ou partie de l’autorité parentale, son aval est indispensable, sauf décision judiciaire de retrait de cette autorité.
Voici les principales conditions à remplir pour que la demande soit recevable :
- L’adoptant doit avoir au moins dix ans de plus que l’enfant à adopter, sauf si le juge accorde une dérogation.
- L’agrément du conseil départemental n’est plus obligatoire pour adopter l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.
- La nationalité française n’est pas exigée pour l’adoptant, mais l’enfant doit résider en France de façon stable.
Au-delà de ces critères, il faut prouver l’existence d’un véritable projet parental partagé, ainsi que la capacité d’assurer le bien-être affectif, éducatif et matériel de l’enfant. Le tribunal judiciaire surveille attentivement le respect de l’intérêt de l’enfant, et veille à l’équilibre de la nouvelle famille.
Étapes clés de la procédure d’adoption simple en France
La procédure d’adoption simple de l’enfant de sa compagne suit un parcours structuré, où chaque phase engage la responsabilité de l’adoptant, du parent d’origine, et du juge. Tout commence par le dépôt d’un dossier d’adoption au tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant. Ce dossier rassemble plusieurs documents : acte de naissance de l’enfant, preuves de vie commune, consentements nécessaires, éléments attestant de la stabilité familiale et de l’engagement parental.
Le recours à un avocat n’est pas imposé, mais son accompagnement se révèle souvent précieux tant le droit de la filiation peut s’avérer complexe. Une fois le dossier complet, le juge vérifie la recevabilité de la demande. Il peut mandater une enquête sociale confiée à l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour évaluer la qualité du lien entre l’adoptant et l’adopté, ainsi que la réalité du projet familial.
Avant de trancher, le procureur de la République donne son avis. L’audience, qui se déroule à huis clos, remet l’intérêt de l’enfant au centre de la décision. Le jugement finalise l’adoption simple : le nouveau lien de filiation se superpose à la filiation d’origine sans la supprimer. Une fois la décision rendue, le livret de famille est actualisé, officialisant la nouvelle situation juridique.
Conséquences juridiques et ressources pour un accompagnement sur mesure
Adopter l’enfant de sa compagne modifie durablement l’équilibre familial, en redistribuant les responsabilités et les droits de chacun. Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoptant partage désormais l’autorité parentale avec le parent biologique. L’adopté garde ses liens avec sa famille d’origine tout en acquérant une nouvelle filiation : il peut porter le nom de famille de l’adoptant, voir son prénom modifié sur décision du juge, et il obtient les mêmes droits successoraux que les enfants nés du couple. Au décès de l’adoptant, l’enfant devient héritier réservataire dans sa nouvelle famille.
Sur le plan de la nationalité française, l’adoption par une personne française permet à l’enfant adopté de la revendiquer sous certaines conditions. Les obligations d’entretien et d’aliments incombent à l’adoptant, qui s’engage à subvenir aux besoins de l’enfant comme le ferait un parent biologique.
Pour s’orienter dans ce parcours, plusieurs intervenants peuvent être sollicités :
- Des avocats spécialisés en droit de la famille ;
- Des notaires pour toute question patrimoniale ;
- Les services sociaux, pour un soutien administratif et un accompagnement psychologique.
Les points d’accès au droit et autres structures d’information sont là pour épauler les familles, qu’elles soient conjoints partenaires pacs, concubins ou époux. Depuis la loi du 21 février 2022, tous les couples peuvent accéder à cette démarche, quel que soit leur statut.
Aucune adoption ne ressemble à une autre : chaque projet familial porte ses propres nuances, ses attentes, ses défis. Le droit s’adapte, mais la singularité de chaque histoire se joue, avant tout, dans l’intérêt de l’enfant.